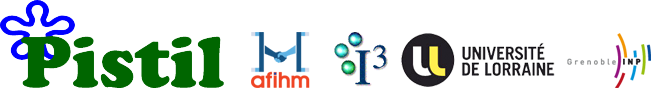PISTIL
Interactions persuasives pour le soutien informatisé de l'engagement
(Persuasive Interaction to Support engagemetT, digItaLly)
Le groupe de recherche PISTIL est un groupe de travail soutenu par l'AFIHM. Ses objectifs sont multiples :
- l'identification de la communauté francophone intéressée par l'interaction engageante ou interfaces motivationnelles
- l'élaboration d'un état de l'art dans le domaine
- la définition d'un agenda de recherche pour les années à venir
- Partager les pratiques et avancées sur les connaissances et les techniques pour la conception des systèmes interactifs d'aide au changement de comportement.
Un des objectifs initiaux était l'étude de l'interaction persuasive autour des enjeux du Développement Durable en Interaction Homme-Machine, en particulier l'étude des Techniques d'Interaction Persuasives pour le développement durable. Depuis 2019, le GT a élargi son champ d'études à d'autres domaines d'application que ce soit la santé, les usages du numériques, le bien-être, etc.
Atelier du GT à la conférence IHM 2025 : participez !
Changement de comportement en psychologie et conception centrée utilisateur
Appel à participation
Depuis l'émergence des technologies persuasives en 1998 à la conférence CHI, de plus en plus d'applications visant tout particulièrement le changement de comportement, notamment en santé, voient le jour. Leur conception repose sur la mise en oeuvre de techniques de changement de comportement visant divers mécanismes psychologique comme l'influence, la motivation ou la prise d'objectifs. Le risque : les concepteurs ont tendance à choisir sans bonne maîtrise des théories issues de la psychologie et à les combiner sans s’assurer de leur cohérence (effet « pick and mix » [Pinder et al., ACM ToCHI 2018]). Combler le manque de formalismes pour spécifier l'interaction de ces systèmes permettrait de gagner en rigueur et méthode.
L'objectif de l’atelier est de sensibiliser les concepteurs d’interfaces motivationnelles, de systèmes persuasifs, de systèmes d’aide au changement de comportement (BCSS ou DBCI), etc, à l’apport de représentations semi-formelles de théories en psychologie du changement de comportement dans le processus de conception centré utilisateur de ces types de système. La sensibilisation sera menée d’un point pratique.
Format de l'atelier
L’atelier consistera en un travail de groupe avec brainstorming à partir de cas d'étude.
Modalités
L’atelier se déroulera le 4 novembre 2025 (infos sur le site de la conférence) et durera 3h. Les personnes souhaitant participer à l’atelier doivent :
Les personnes souhaitant participer à l’atelier doivent :
- S’inscrire de manière régulière à l’atelier lors de l’inscription à la conférence et
- Envoyer un message de participation aux organisateurs (voir email ci-dessous) avant le 23 octobre 2025.
Contacts
- Christian Bastien, christian.bastien@univ-lorraine.fr, UL/Perseus
- Yann Laurillau, Yann.Laurillau@univ-grenoble-alpes.fr, UGA/Laboratoire LIG
- Jean-Claude Martin, jean-claude.martin@universite-paris-saclay.fr, Université Paris-Saclay/LISN